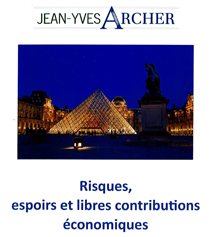La désintermédiation financière : quel bilan ?
En quelques dizaines d’années, la désintermédiation financière ( l’accès aux financements directement sur les marchés pour les entreprises en quête de capitaux ) est devenu un fait majeur et probablement irréversible. Comme toute avancée technique et économique, elle présente des avantages et comporte des risques. Esquissons un bilan d’étape.

La désintermédiation financière : quel bilan ?
La désintermédiation financière fait l’objet d’un consensus quant à sa définition. Ainsi, le Vernimmen ( page 351 de l’édition 2013 ) définit la désintermédiation comme « le passage d’une économie d’endettement à une économie de marchés financiers. Dans ce cas une part importante des financements obtenus et des placements réalisés par les entreprises se fait directement sur les marchés financiers sans passer par l’écran d’un intermédiaire financier dont le rôle se réduit d’un emprunteur/prêteur à celui d’un placeur des titres sur le marché financier ».
Là où l’intermédiation financière relève du monopole des établissements de crédit seuls habilités à recevoir des dépôts et à les transformer en crédits ( Code monétaire et financier ), la désintermédiation met les entreprises directement face au vent du large, directement en liens d’attraction/séduction avec les détenteurs de capitaux.
Le financement des entreprises relève beaucoup moins de l’endettement bancaire mais d’émission de titres de créances négociables ( billets de trésorerie, bons à moyen terme négociables ) dont le suivi, en cas d’émission de valeurs mobilières complexes, est généralement assuré par les banques au titre d’opérations de haut de bilan. Ces dernières générant des commissions (« fees ») par contraste avec la perception d’intérêts liés à un prêt classique.
En premier lieu, un point positif émerge spontanément : la désintermédiation serait favorable dans la mesure où elle supprime un intermédiaire dans un circuit de financement et surtout qu’elle permet aux entreprises, au prix de « road-shows », de se présenter aux marchés et d’éviter le pesant contrôle d’opportunité bancaire dont Pierre Moussa ( ex-patron brillant de Paribas ) disait : « Qu’on le veuille ou non, un banquier c’est un monsieur qui dit oui ou qui dit non ! ». ( 1980 ).
Il y a donc un premier point positif qui réside dans la pleine concurrence à comparer avec les situations qui existent parfois de cartels bancaires et de mimétismes d’appréciation d’un dossier de financement.
En deuxième lieu, la désintermédiation financière présente un autre aspect positif : elle permet d’éviter les conduites bancaires dans lesquelles un banquier leader est en capacité d’anticiper, selon l’effet dit Stackelberg, la fonction de réaction de la banque concurrente. ( dite satellite ). Autrement dit de se placer en position de dicter ses conditions de prêteur de manière quasi-impérative.
En troisième lieu, la désintermédiation financière est un atout du fait de la globalisation financière qui a la plupart du temps permis d’accroître l’efficience allocative et informationnelle des marchés.
En quatrième lieu, la désintermédiation financière a évité aux entreprises d’être engluées dans les difficultés propres au secteur bancaire. Ainsi, ce dernier doit faire face de front aux nouvelles règles prudentielles ( Long Term Funding Ration de Bâle III ) qui augmentent significativement le besoin de financement à moyen et long terme des établissements financiers. De plus, le secteur bancaire doit faire face aux nouvelles exigences de fonds propres règlementaires qui contribuent à limiter la possibilité d’augmentation de la taille du bilan. Enfin, le secteur bancaire connait une sorte d’effet de ciseaux puisque ces marges de taux d’intérêt sur les crédits consentis ne s’accroissent pas aussi fortement que les coûts de financement.
En cinquième lieu, le ciel s’assombrit considérablement lorsqu’on relève que les banques, dans leur activité classique, ont accordé des prêts à haut risque ( « subprimes ») qu’elles ont de surcroît titrisés. C’est à dire qu’elles ont transformé ces crédits en titres et les ont placées sur les marchés financiers. Alors qu’une banque qui effectue un prêt doit parallèlement augmenter ses fonds propres ce qui autolimite la distribution de crédit ( voir théorie du surendettement de Fisher ), la titrisation a rendu moins vigilant les établissements de crédit quant à leurs politiques respectives de prêts.
Dans ce contexte, on peut donc poser que la titrisation sera utilisée avec parcimonie par opposition au recours, comme aux Etats-Unis, au marché des obligations « high-yield » qui est toutefois risqué en phase de récession au regard de la pérennité des entreprises elles-mêmes.
En sixième lieu, la désintermédiation financière – même si elle est imparfaite et le plus souvent réservée à des firmes de grande taille – est moins pénalisante que la politique de distribution de crédit bancaire via des emprunts structurés dont pâtissent nombre de collectivités locales suite – notamment – au dynamisme de banques telles que Dexia.
On rappelle qu’un emprunt structuré est un emprunt à taux variable en fonction de son indice financier de référence. Cet emprunt est dit structuré car une première période est soumise à un taux d’intérêt faible alors qu’en deuxième période contractuelle, il est lié à des indices complexes ou à des parités monétaires de type euro-franc suisse.
En septième lieu, la désintermédiation se nourrit d’un inconvénient sensible qui concerne la lisibilité des états comptables bancaires. La « mobiliérisation » des bilans bancaires ( c’est à dire la présence croissante de valeurs mobilières en leurs lignes ) a profondément changé les choses : les dépôts ( ressources traditionnelles des banques ) représentaient 26% du passif bancaire en 2010 contre 87% en 1980. Ce qui signifie, de manière capitale, que le propre coût de financement des banques est fixé au terme de validation par les marchés eux-mêmes. Sans caricaturer, les banques se sont laissées entraîner dans la désintermédiation à corps perdus.
Symétriquement, l’actif des banques a enregistré cette mobiliérisation des bilans puisque les titres représentent désormais entre 30 à 40% de l’actif tandis que la part des crédits reculait de 85% en 1980 à 30% en 2010.
Cet inconvénient sensible quant à la lecture appropriée des bilans bancaires est aggravée par l’imperfection des « nécessaires réglages bilatéraux » fort opportunément citée par le Président Jérôme Haas ( Autorité des Normes Comptables ). Il évoque ainsi ( dans la dernière livraison de Ena mensuel d’Octobre 2012 ) le besoin d’harmonie des principes comptables entre Etats-Unis et Europe, la délicate question de l’extra-territorialité de lois américaines et autres points qui rendent ardues les comparaisons factuelles et bilancielles.
En huitième lieu, Michel Albert avait opposé le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rhénan ( in Capitalisme contre capitalisme, 1991 ) et insistait sur l’aspect de partenaire de l’entreprise qui caractérisait alors les banques opérant Outre-Rhin. L’auteur y voyait une des clefs du succès allemand et de la croissance des PME.
De nos jours, là-bas aussi, la désintermédiation a changé la donne.
Ce qui est certain, c’est que la conjugaison des exigences de Bâle III, les méfiances symétriques sur le marché interbancaire et la montée des créances douteuses au sein des actifs des bilans bancaires ( voir Espagne ) conduisent à un resserrement du crédit : à un « credit crunch » qui concerne toutes les tailles d’entreprise.
En Europe, il est actuellement difficile de trouver des financements pour l’innovation d’une jeune PME ou pour la consolidation d’un grand projet international. Bien évidemment, cet état de faits a un retentissement sur la croissance.
Dans ces conditions, la désintermédiation financière présente un bilan nuancé mais finalement positif pour ce qui concerne le financement. N’oublions pas que les banques conservent au moins deux activités attractives : celle de l’ingénierie de haut de bilan ( banques d’affaires ) et celle de placements de trésorerie.
Pour le reste, nous avons d’ores et déjà écrit dans ces colonnes que la crise allait entraîner un mouvement de concentration bancaire.
Dès le 22 Juin 1999, un expert reconnu écrivait dans 01 Informatique : « Les banquiers sont capables de prendre des risques inconsidérés pour se manger les uns les autres, mais pas pour financer les start-up » : Dominique Strauss-Kahn.